
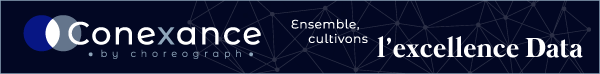

Poussé par des réglementations de plus en plus restrictives, Facebook offre depuis quelque temps à ses inscrits l’alternative de continuer à utiliser le service gratuitement – en échange de l’exploitation de leurs données – ou de payer un abonnement, synonyme d’une préservation plus grande de leur vie privée. Nonobstant le fait que l’offre soit actuellement contestée par la Commission européenne, l’initiative peut paraître élégante et saine. Mais ne serait-elle pas un peu tardive ?
Qui n’a pas souvenir de ce premier écran d’inscription au service qui annonçait fièrement : « Facebook est gratuit, et le restera ! » ? Je me suis toujours demandé ce que cachait cette affirmation péremptoire. Était-ce une véritable démarche philanthropique, celle d’ouvrir le réseau social au plus grand nombre sans distinction de moyens ? Ou la manifestation d’une naïveté de jeune créateur encore étudiant, convaincu que le web devait et pouvait être gratuit ? Ou bien, plus probablement, le cynisme déjà affûté d’un businessman qui déroulait là son premier argument de vente pour capter massivement des inscrits, reprenant le bon vieil attrape-nigaud du « gratuit et sans engagement » ? Avec le recul, il est aisé de choisir la bonne option.
Il faut reconnaître que sans cette gratuité initiale, Facebook n’aurait pas connu un tel succès. Remettons-nous dans le contexte de l’époque, partagée avec les autres réseaux sociaux tels que Twitter ou LinkedIn, nés dans les mêmes années. Peu de gens comprenaient à quoi pouvaient bien servir ces « machins » où l’on passait son temps à parcourir le profil d’inconnus, à « poker » ou « liker » des photos, ou à commenter des discussions qui n’allaient en rien changer la face du monde (bien que…). Une utilité a priori futile. Alors, qui aurait payé ne serait-ce qu’un dollar pour liker la photo d’une amie en maillot de bain ou pour réagir à un énième « carpe diem » ? Personne. Pire encore : qui accepterait aujourd’hui de payer pour pouvoir insulter anonymement un autre inscrit, dimension essentielle du succès de ces plateformes ? C’est là le paradoxe central : ce type de service n’a pris sens et valeur que parce qu’il était gratuit. On n’est pas loin de l’analogie du dealer qui distribue d’abord sa drogue gratuitement pour mieux en vendre ensuite à ses nouveaux adeptes.
À cette dimension gratuite s’est ajouté un contexte technologique décisif et qui a fait le terreau du service : le passage, au tournant des années 2000, d’un Internet bas débit intermittent via le téléphone à des connexions haut débit continues grâce à l’ADSL puis à la fibre. Les dialogues en direct et les notifications immédiates – fondements mêmes de Facebook – n’auraient pas eu le même impact sans cette infrastructure. Bonus supplémentaire, elle restait financée par les consommateurs eux-mêmes via leurs abonnements. Imaginez un instant si ces plateformes, à l’instar d’Amazon ou de Netflix, avaient dû supporter elles-mêmes le coût de leur mise en relation avec leurs utilisateurs : leur business n’aurait sans doute pas été aussi florissant.
Aujourd’hui, Facebook peut s’enorgueillir de proposer deux formules claires : gratuit avec publicité ou payant sans publicité. Posée ainsi, l’équation semble séduisante, mais elle ne paraît pas efficace. L’exemple de YouTube est révélateur : malgré ses 2,7 milliards d’utilisateurs mensuels, seuls 125 millions paient un abonnement (à 13 €/mois), soit moins de 5 %. Passer d’un service gratuit vers un payant pour un produit similaire ne semble donc pas chose aisée.
Pour Facebook, les chiffres sont rares, mais on sait que ses revenus publicitaires par utilisateur atteignent en moyenne 157 $ par an aux États-Unis et 80 $ en France. Or, avec un abonnement fixé à 5,99 €/mois – soit 72 € par an –, Facebook gagnerait moins qu’avec la publicité. Pas étonnant que cette offre ne soit que discrètement mise en avant.
Il faut néanmoins s’interroger : le rapport des internautes à la gratuité n’a-t-il pas évolué ? Les jeunes générations, habituées aux abonnements Spotify, Netflix ou aux microtransactions dans les jeux vidéo, sont peut-être plus enclines à payer quelques euros pour échapper à la publicité et protéger leurs données. La gratuité n’a plus le même caractère sacré que dans la première ère du web.
Reste que la publicité n’est pas le seul problème. Le cœur de l’économie de Facebook repose sur l’attention : le temps passé en ligne, l’engagement, l’addiction. Or, payer un abonnement n’élimine pas cette logique algorithmique qui pousse à scroller toujours plus. La question devient alors : paie-t-on vraiment pour plus de liberté, ou seulement pour moins de nuisances visibles ?
Ainsi, en introduisant tardivement une option payante, Facebook répond à la pression réglementaire et aux critiques sur la protection des données. Mais son modèle économique demeure verrouillé par la publicité et ses utilisateurs conditionnés à la gratuité. À moins d’un changement culturel profond ou d’une contrainte légale forte, l’abonnement restera donc un produit de niche. Mais le véritable enjeu n’est pas de choisir entre « gratuit avec pub » et « payant sans pub », il est peut-être de repenser la valeur que nous accordons à nos interactions numériques et le prix – en argent ou en attention – que nous sommes prêts à payer pour les préserver.

En vous inscrivant à la newsletter vous acceptez de recevoir des mails de Digital Mag sur son actualité et ses offres en cours. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire dans la partie basse des Newsletters envoyées.